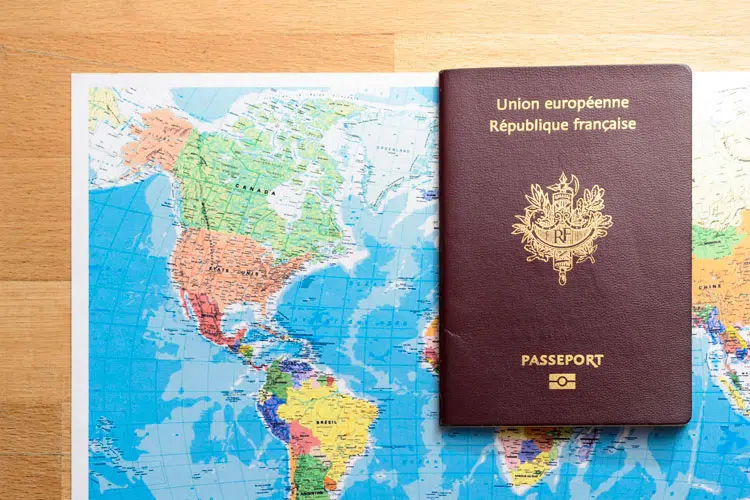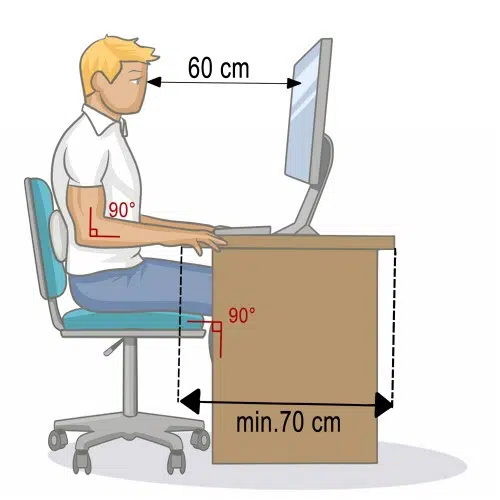L’État n’indemnise plus le premier jour d’arrêt maladie pour ses agents depuis 2018. Cette règle, loin d’être universelle, épargne toutefois les arrêts pour affection longue durée, ainsi que certaines situations liées à la maternité ou à la paternité.Les statistiques de l’absentéisme dans la fonction publique affichent depuis lors des variations notables. Plusieurs rapports interrogent aujourd’hui la portée réelle de la mesure sur la diminution des arrêts courts, alors que des syndicats comme certains spécialistes alertent sur ses répercussions concrètes dans le quotidien des agents et l’ambiance de travail.
Le jour de carence dans la fonction publique : définition et cadre légal
Quand un agent public s’arrête pour maladie, le fameux jour de carence signifie qu’il ne touchera aucun traitement ce premier jour d’absence. Depuis 2018, cette règle s’applique sans distinction à tous, sauf dans quelques cas explicitement prévus par la loi. Malgré son apparente simplicité, la réalité n’est pas uniforme, car certains agents échappent à cette règle.
Dans la fonction publique, plusieurs exceptions existent à cette journée de non-paiement :
- Les agents victimes d’un accident de service ou souffrant d’une maladie professionnelle ne subissent pas cette retenue.
- Ceux atteints d’une affection longue durée (ALD) bénéficient d’une indemnisation dès le premier jour.
- Les arrêts liés à une maternité, paternité, ou au décès d’un enfant ne donnent pas non plus lieu à la suppression du traitement.
La loi fait donc une nette distinction entre maladie ordinaire et circonstances particulières comme la maladie professionnelle ou l’invalidité temporaire liée au service. L’objectif affiché est d’harmoniser la gestion des congés maladie entre les secteurs public et privé, avec trois jours non indemnisés du côté des salariés, pris en charge par la Sécurité sociale.
Concrètement, si un agent tombe malade, la première journée ne lui sera pas payée. À partir du second jour, la rémunération reprend, sauf selon le statut ou la complémentaire. D’où la naissance de situations singulières au sein du service public, sujettes à débat selon les contextes.
Pourquoi cette mesure suscite-t-elle autant de débats chez les agents publics ?
La question centrale, c’est la sensation de subir une injustice. Beaucoup d’agents estiment payer le prix de leur métier sans que la réalité de leur travail soit prise en compte. Rares sont les secteurs aussi divers que la fonction publique : entre un prof du secondaire, une professionnelle hospitalière ou un agent dans une petite collectivité, le quotidien diffère, mais la règle du jour de carence frappe pareil.
Ce dispositif est souvent présenté comme un alignement avec le secteur privé. Mais cette comparaison a ses failles. Les tâches et les horaires imposés aux agents du service public n’ont souvent rien d’équivalent en dehors : amplitude, astreintes, missions à rallonge… Les syndicats de la fonction publique, notamment la CGT et la FSU, insistent surtout sur les conséquences pour les plus exposés et ceux qui touchent les plus bas salaires. Pour eux, cette retenue ressemble à une double sanction : perte de revenu et sentiment d’être montrés du doigt, alors que la pression et la précarité sur le terrain restent palpables.
Côté gouvernement, l’une des justifications récurrentes est l’économie budgétaire, estimée à plusieurs millions d’euros. Pourtant, la plupart des agents publics n’ont pas la même couverture en cas de maladie que de nombreux salariés. Ce dialogue de sourds entre gestion financière et réalité du terrain ne faiblit pas, et le malaise persiste.
Conséquences concrètes sur les arrêts maladie et le quotidien des fonctionnaires
Depuis l’instauration de la journée de carence, les habitudes ont changé. Sur le terrain, beaucoup racontent qu’ils hésitent désormais à s’arrêter, quitte à repousser, voire annuler un congé maladie pourtant recommandé. Le présentéisme s’est imposé : on continue à travailler, fiévreux, pour ne pas perdre une journée de salaire. Dans certains services, l’idée même de s’absenter une journée pose débat, surtout en période d’épidémie.
Au niveau des chiffres, les premières années de la mesure montrent une baisse nette des arrêts maladie de courte durée, mais une hausse des absences longues. À force d’attendre, certains agents aggravent leur état et restent ensuite loin du service pour des périodes bien plus longues. L’organisation des équipes en pâtit, la charge de travail se concentre, ce qui alourdit la pression générale.
Les échanges avec les syndicats traduisent une méfiance croissante. Le dialogue social se tend. On reproche à la mesure de n’être qu’un outil comptable, sans impact réel sur le fond. Les personnes les plus fragiles paient au prix fort la perte de revenu, tout en subissant la contrainte de rester à leur poste, parfois au détriment de leur santé. Au fil des mois, la question de la protection sociale dans la fonction publique grandit, faute de réelle politique de prévention efficace et adaptée.
Ce que disent les études et les chiffres récents sur l’efficacité du jour de carence
Depuis que le jour de carence fait partie intégrante de la fonction publique, analyses et rapports fouillent la question, mais peinent à offrir une vision claire et unanime. D’un côté, les communications officielles évoquent une diminution rapide des arrêts maladie courts chez les agents. Mais sur le terrain, la réalité dépasse les courbes.
Diverses études pointent une réduction du volume global des indemnités versées pour les arrêts de très courte durée. Toutefois, beaucoup constatent aussi que le présentéisme a progressé. À l’hôpital notamment, la tendance est à l’attente : bon nombre d’agents retardent l’arrêt, puis finissent par s’absenter plus longtemps, parfois épuisés.
Quelques tendances marquantes se dégagent :
- Selon la Direction générale de l’administration, environ 170 millions d’euros ne sont plus distribués chaque année à cause de la mesure.
- Les arrêts d’une journée se raréfient, alors que les durées moyennes d’absence se rallongent.
Comparé au secteur privé, le public s’adapte différemment. Dans un cas comme dans l’autre, les stratégies mises en place finissent par se ressembler : on compose avec le système, quitte à repousser les problématiques de santé. Les syndicats, eux, rappellent le manque cruel d’évaluation sur la qualité de vie au travail et l’absence d’avancée notable en prévention.
Au terme de ce tour d’horizon, une chose reste en suspens : entre économies budgétaires et adaptation forcée des agents, la journée de carence aggrave les tensions et interroge la capacité du service public à conjuguer santé des travailleurs et qualité du service quotidien. Jusqu’où la corde peut-elle être tirée sans casser tout l’équilibre ?